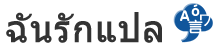- ข้อความ
- ประวัติศาสตร์
De plus, les personnifications succ
De plus, les personnifications successives des éléments naturels (emploi de l'impératif v.14 et du « vous » v.4 et 8, introduisant une symétrie dans la chute des quatrains qui entretient la confusion entre la voix de la nature et celle du poète) trompent l'attente du lecteur : alors qu'on pouvait s'attendre à un poème d'amour, on se trouve en présence d'une plainte amoureuse (ton élégiaque). Les allitérations en [v] du premier quatrain renforcent le caractère intimiste de cette plainte, juste murmurée comme le montre la simplicité syntaxique des quatrains : les vers 1 à 8 sont constitués d'une longue énumération de groupes nominaux coordonnés par « et ». Il faut attendre les tercets pour trouver des propositions subordonnées (v.9 et 10) et incise (v.11-12) qui précisent le sujet de ce poème. La proposition principale est rejetée dans le dernier hémistiche, à l'ultime vers, pour offrir la chute du poème, qui constitue aussi son principal argument. Toutefois, la surprise du dernier vers a été préparée tout au long du texte par la personnification subtile de la nature en femme, grâce à un jeu sensuel d'oppositions mimant le jeu de la séduction : les formes rondes (« monts » v.1, « vallons » v.7, « bossus » v.7) offertes à la vue (« découverts » v.1, « ouverts » v.5) alternent avec les formes qui se cachent, comme pour se refuser au poète (« ondoyantes », « tors » v.3). Le jeu des sens complète cette allusion à la séduction exercée par la nature féminine sur l'homme : sont sollicités la vue (« découverts » v.1, « verdoyantes » v.2), le toucher (« moussus » v.5), l'odeur et le goût (« vineux » v.2).
0/5000
นอกจากนี้ personifications ต่อเนื่องขององค์ประกอบธรรมชาติ (ใช้ความจำเป็น v.14 และ 'คุณ' v.4 และ 8 แนะนำสมมาตรในฤดูใบไม้ร่วงของ quatrains ซึ่งทำให้เกิดความสับสนระหว่างเสียง ของธรรมชาติ และกวี) เข้าใจผิดความคาดหวังของผู้อ่าน: ขณะอาจคาดหวังความรักบทกวี อยู่ในการร้องเรียนของความรัก (คุณ elegiac) Alliteration ใน [v] ของ quatrain แรกเสริมสร้างอักขระส่วนตัวร้องทุกข์นี้ เพียงกระซิบดังแสดงในความเรียบง่ายทางไวยากรณ์ของ quatrains: ข้อ 1-8 ประกอบด้วยรายการของกลุ่มที่กำหนดโดย «และ» คุณควรรอ tercets เพื่อค้นหาข้อเสนอรอง (v.9-10) และ incised (v. 11-12) ซึ่งระบุชื่อเรื่องของบทกวี ข้อเสนอหลักการถูกปฏิเสธในการ hemistich ครั้งสุดท้าย การหนอนไวรัสที่ดีที่สุด ให้ตกจากบทกวี ซึ่งเป็นอาร์กิวเมนต์หลัก อย่างไรก็ตาม ความประหลาดใจของเพลงสุดท้ายได้ถูกเตรียมไว้ตลอดข้อความ โดยบุคลาธิษฐานที่ละเอียดอ่อนของธรรมชาติในผู้หญิง ผ่านเกมเช็ก oppositions นั่งเกมของการล่อลวง: ฟอร์มกลม («bossus » «valleys"v.7 "ภูเขา"ร่าง v.7) เสนอมุมมอง («พบ» ร่าง 'เปิด' v.5) สลับกับฟอร์มที่ซ่อน เป็นปฏิเสธ (กวี 'รีด' (, v.3 'แปรปรวน') เกมของความรู้สึกเต็มนี้อเดิมเกลี้ยกล่อมโดยธรรมชาติของผู้หญิงในมนุษย์: จะร้องขอดู («พบ» ร่าง v.2 "สีเขียว"), ("มอสซี" v.5) สัมผัส กลิ่น และรสชาติ («vinous » v.2)
การแปล กรุณารอสักครู่..


นอกจากนี้บุคลาธิษฐานเนื่องขององค์ประกอบธรรมชาติ (ใช้ v.14 ความจำเป็นและ "คุณ" และ 8 v.4 แนะนำสมมาตรในฤดูใบไม้ร่วง quatrains ซึ่งรักษาความสับสนระหว่างเสียงของธรรมชาติและของที่ กวี) หลอกลวงความคาดหวังของผู้อ่าน: เมื่อเราสามารถคาดหวังบทกวีความรักหนึ่งคือในที่ที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับความรัก (เสียงเศร้าโศกเสียใจ) สัมผัสอักษรใน [V] ของบรรทัดแรกเสริมสร้างความใกล้ชิดธรรมชาติที่มีการร้องเรียนนี้เพียงกระซิบที่แสดงความเรียบง่ายของการสร้างประโยค quatrains: โองการ 1-8 ประกอบด้วยรายการยาวของกลุ่มระบุการประสานงานโดย "และ." ไม่ได้จนกว่าแฝดเพื่อค้นหาบุรพบท (เทียบกับ 9 และ 10) และ Incise (v.11-12) ที่ระบุเรื่องของบทกวี ข้อเสนอหลักถูกปฏิเสธในช่วงครึ่งปีหลัง, การที่ดีที่สุดที่จะนำเสนอการล่มสลายของบทกวีซึ่งเป็นเหตุผลหลักของมัน แต่ที่น่าแปลกใจของบทกวีที่ผ่านมาถูกจัดทำขึ้นตลอดข้อความโดยตนที่ลึกซึ้งของธรรมชาติเป็นผู้หญิงที่มีเกมราคะของลอกเลียนแบบเกมตรงข้ามเดท: รูปทรงกลม ( "ภูเขา" v.1 "เทือก" V.7 "ค่อม" V.7) เสนอขายให้กับมุมมอง ( "ค้นพบ" v.1 "เปิด" V.5) สลับกับรูปแบบที่ซ่อนเช่นถ้าจะปฏิเสธกวี ( " กลิ้ง "," บิด "V.3) เกมของความสมบูรณ์พาดพิงนี้เพื่อยั่วยวนของธรรมชาติที่เป็นผู้หญิงของมนุษย์ที่มีการร้องขอเข้าชม ( "พบ" v.1 "สีเขียว" V.2) สัมผัส ( "มอสส์" V.5) กลิ่นและรสชาติ ( "winey" V.2)
การแปล กรุณารอสักครู่..


ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.
- แต่ไม่ว่าวันเวลา จะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร
- Creatif
- กินข้าวพร้อมกับดูทีวีไปด้วย
- What I have asked
- ปรับปรุงใบสั่งซื้อให้เราด้วยค่ะ
- คุณเคยมาที่ไทยมั้ย
- ตอนมีชีวิตอยู่ ควรทำความดีให้มากๆอย่าขี้
- เครื่องดื่มต้องการการทดสอบเพื่อต้องการข้
- Steve Jobs was my idol since I knew who
- พอไปถึง ฉันก็ไปซื้อตั๋วรถไฟออกจากชานชลา
- Finally, Urban Heat Island are caused by
- cavitation corrosion
- ขอบคุณ
- But what is permanent is legend... As a
- พอไปถึง ฉันก็ไปซื้อตั๋วรถไฟออกจากชานชลา
- Please see an attached file for more det
- ชื่อจริง สลิลทิพย์
- หากเรามีทรัพยากรเหล่านี้อยู่มากมายหรือมี
- Continuous Improvement andBest Practice
- promises
- Compensation income from goods loss
- สถานที่ที่ได้รับความนิยม
- Based largely on a Koranic prescription
- ผู้ว่าราช