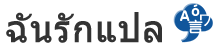- ข้อความ
- ประวัติศาสตร์
Les légendes locales du Puy-en-Vela
Les légendes locales du Puy-en-Velay évoluent autour d'un dolmen qui occupait depuis plusieurs millénaires, sans doute, l'emplacement actuel de la cathédrale. Il reste de cette pierre basaltique une partie conservée dans une chapelle du Saint-Crucifix connue sous le nom de Pierre des Fièvres ou Pierre des Apparitions, sorte de dalle de 3 m de longueur sur 2 m de largeur. C'est sur ce dolmen que serait apparue au iiie siècle la Vierge à une matrone du Puy souffrant d’une fièvre quarte, lui annonçant qu'elle serait guérie en allant s'étendre sur le dolmen. À la suite de la guérison, la dame serait allée voir l'évêque Georges du Velay, considéré comme le premier apôtre du Velay, qui marque les plans d'un modeste oratoire à la Vierge sur l'emplacement décrit par un cerf. Deux siècles plus tard, une autre guérison est mentionnée à l'évêque Vosy qui obtient de Rome l'autorisation de transférer le siège de l'évêché de Ruessio (capitale vellave gallo-romaine) à Anicium (nom gallo-romain du Puy-en-Velay, dont le radical « an » signifie en langue celtique « cercle, circuit, enceinte ») et décide de construire une église-cathédrale. la construction débute avec son successeur l'évêque Scutaire. Selon la tradition locale, l'église angélique est sanctifiée par des anges qui transfèrent de Rome des reliques[2].
En réalité, ces légendes sont formées à partir de la toponymie du rocher qui surplombe l'emplacement du sanctuaire actuel et qui porte le nom de Corneille dont l'étymologie dérive du cerf Cernunnos, dieu gaulois, le site étant un ancien souvenir du culte de cette divnité. Le sanctuaire marial devient rapidement le siège d'un pèlerinage.
Avec cette légende, le Puy-en-Velay est, avec Chartres, le plus ancien sanctuaire marial de la Gaule chrétienne. On a retrouvé sous le pavé du chœur les fondations de cette première église qui mesurait 12 m × 24 m. De nos jours encore, des pèlerins s'allongent sur la pierre pour en recevoir les bienfaits.
Si l'origine du culte de Notre-Dame-de-l'Annonciation se trouve dans la Pierre aux Fièvres, le Moyen Âge et les temps modernes vénèrent surtout la Vierge noire.
En réalité, ces légendes sont formées à partir de la toponymie du rocher qui surplombe l'emplacement du sanctuaire actuel et qui porte le nom de Corneille dont l'étymologie dérive du cerf Cernunnos, dieu gaulois, le site étant un ancien souvenir du culte de cette divnité. Le sanctuaire marial devient rapidement le siège d'un pèlerinage.
Avec cette légende, le Puy-en-Velay est, avec Chartres, le plus ancien sanctuaire marial de la Gaule chrétienne. On a retrouvé sous le pavé du chœur les fondations de cette première église qui mesurait 12 m × 24 m. De nos jours encore, des pèlerins s'allongent sur la pierre pour en recevoir les bienfaits.
Si l'origine du culte de Notre-Dame-de-l'Annonciation se trouve dans la Pierre aux Fièvres, le Moyen Âge et les temps modernes vénèrent surtout la Vierge noire.
0/5000
ตำนานท้องถิ่นของทดสอบ Puy en Velay วิวัฒนาการทั่ว dolmen ที่ครอบครองนับพันปี ข้อสงสัย ตำแหน่งปัจจุบันของวิหาร ซากของ part นี้หินรับเก็บไว้ในชาเปลแห่งกางเขนศักดิ์สิทธิ์รู้จักกับหินของไข้หรือหินของเรื่องผี เรียงลำดับของพื้น 3 เมตรยาว 2 เมตรกว้าง บนนี้ dolmen ที่จะปรากฏในศตวรรษสามบริสุทธิ์ไปเป็นท้าวนางทดสอบ Puy ทุกข์ทรมานจากไข้สี่ ประกาศว่า เธอจะรักษาให้หายได้ โดยไปขยาย dolmen ได้ หลังการรักษา เลดี้จะไปดูจอร์จบิชอปของ Velay ถือว่าเป็นการแรกอัครสาวกของ Velay ซึ่งเป็นเครื่องหมายโอราทอรีเจียมเนื้อเจียมตัวมีแผนจะบริสุทธิ์ในสถานที่โดยกวาง สองศตวรรษต่อมา การรักษาอื่นกล่าวถึงใน Vosy มุขนายกที่ได้รับสิทธิ์ในการโอนย้ายนั่งของบิชอป Ruessio (โรมันกอลโล vellave ทุน) ไปโรม Anicium (กอลโลโรมันชื่อการทดสอบ Puy-en-Velay รวมทั้งอนุมูลอิสระในภาษาหมายถึง 'ปี' เซลติก 'วง วงจร ตั้งครรภ์') และตัดสินใจสร้างโบสถ์วิหาร การก่อสร้างเริ่มต้น ด้วยการสืบ Scutaire บิชอป ตามประเพณีท้องถิ่น โบสถ์งามที่บริสุทธิ์ โดยเทวดาที่โรมของธาตุ [2] การถ่ายโอนในความเป็นจริง ตำนานเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากภูมินามวิทยาของหินซึ่งสามารถมองเห็นตำแหน่งที่ตั้งของวิหารปัจจุบัน และที่มีชื่อของคอร์นีศัพทมูลวิทยาได้รับมาจากกวาง Cernunnos พระ Gaulish เว็บไซต์การมีหน่วยความจำเดิมของลัทธิของ divnite นี้ ศาลเจ้า Marian อย่างรวดเร็วกลายเป็นนั่งของบุญด้วยตำนานนี้ การทดสอบ Puy-en-Velay กับชาร์เทรส เป็น Marian วิหารเก่าแก่ที่สุดของกอลคริสเตียน เราอยู่ใต้ถนนของมูลนิธินักร้องประสานเสียงของโบสถ์นี้แรกซึ่งวัดได้ 12 m × 24 วันนี้นายยังคง ผู้แสวงบุญวางบนหินที่ได้รับประโยชน์ถ้าต้นกำเนิดของลัทธิของผู้หญิงของเรา -ของ - การประกาศของเทพอยู่ในหินจะเป็นไข้ ยุคกลางและยุคเคารพพระแม่มารีดำโดยเฉพาะ
การแปล กรุณารอสักครู่..


ตำนานท้องถิ่น Puy-en-Velay วิวัฒนาการรอบ Dolmen ซึ่งครอบครองเป็นพัน ๆ ปีอาจจะเว็บไซต์ปัจจุบันของมหาวิหาร มันยังคงเป็นส่วนหนึ่งของหินบะซอลนี้เก็บรักษาไว้ในโบสถ์ของไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ที่รู้จักกันเป็นหินของไข้หรือปีเตอร์ผีชนิดของพื้น 3 เมตรยาว 2 เมตรกว้าง มันอยู่บน Dolmen นี้ที่จะได้ปรากฏตัวขึ้นในศตวรรษที่สามมาดอนน่ากับหญิงวัยกลางคนที่ทุกข์ทรมานจาก Puy quartan ที่ประกาศว่าเธอจะรักษาให้หายขาดได้โดยไปที่อาศัยอยู่บนสร้างวัด หลังจากการรักษาผู้หญิงจะได้ไปเพื่อดูบิชอปจอร์จ Velay พิจารณา Velay อัครสาวกแรกซึ่งนับเป็นแผนการของปราศรัยขนาดเล็กให้กับเวอร์จินเกี่ยวกับสถานที่อธิบายโดยกวาง สองศตวรรษต่อมารักษาที่อื่นถูกกล่าวถึงใน Vosy บิชอปผู้ที่ได้รับไปยังกรุงโรมได้รับอนุญาตในการถ่ายโอนที่นั่งของบิชอปแห่ง Ruessio (Vellave โรมัน Gallo Capital) เพื่อ Anicium (ชื่อโรมัน Gallo ของ Puy-en -Velay ซึ่งรุนแรง "เป็น" เซลติกหมายถึง "วงกลมวงจรตั้งครรภ์") และตัดสินใจที่จะสร้างโบสถ์วิหาร การก่อสร้างเริ่มต้นด้วยทายาทบิชอป Scutaire ตามประเพณีท้องถิ่นโบสถ์เป็นบาปโดยเทวดาเทพธิดาที่ถ่ายโอนไปยังพระธาตุโรม. [2]
ในความเป็นจริงตำนานเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากชื่อสถานที่ของหินที่สามารถมองเห็นเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันและนำ ชื่อคอร์นีเลียซึ่งมีรากศัพท์มาจากกวาง Cernunnos พระเจ้าฝรั่งเศส, เว็บไซต์ที่มีหน่วยความจำโบราณของศาสนาของdivnitéนี้ The Sanctuary แมเร็ว ๆ นี้จะกลายเป็นเว็บไซต์ของการแสวงบุญที่.
ด้วยตำนานนี้ Le Puy-en-Velay เป็นพร้อมกับชาตที่เก่าแก่ที่สุดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แมคริสเตียนกอล ก็พบว่าภายใต้คณะนักร้องประสานเสียงของฐานรากแพดของคริสตจักรแรกที่วัด 12 เมตร× 24 เมตร แม้วันนี้ผู้แสวงบุญอยู่บนก้อนหินที่จะได้รับผลประโยชน์.
ถ้าต้นกำเนิดของศาสนาของพระแม่แห่งการประกาศของเราตั้งอยู่ในปีเตอร์ไข้ที่ยุคกลางและยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบูชาสีดำมาดอนน่า
ในความเป็นจริงตำนานเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากชื่อสถานที่ของหินที่สามารถมองเห็นเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันและนำ ชื่อคอร์นีเลียซึ่งมีรากศัพท์มาจากกวาง Cernunnos พระเจ้าฝรั่งเศส, เว็บไซต์ที่มีหน่วยความจำโบราณของศาสนาของdivnitéนี้ The Sanctuary แมเร็ว ๆ นี้จะกลายเป็นเว็บไซต์ของการแสวงบุญที่.
ด้วยตำนานนี้ Le Puy-en-Velay เป็นพร้อมกับชาตที่เก่าแก่ที่สุดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แมคริสเตียนกอล ก็พบว่าภายใต้คณะนักร้องประสานเสียงของฐานรากแพดของคริสตจักรแรกที่วัด 12 เมตร× 24 เมตร แม้วันนี้ผู้แสวงบุญอยู่บนก้อนหินที่จะได้รับผลประโยชน์.
ถ้าต้นกำเนิดของศาสนาของพระแม่แห่งการประกาศของเราตั้งอยู่ในปีเตอร์ไข้ที่ยุคกลางและยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบูชาสีดำมาดอนน่า
การแปล กรุณารอสักครู่..


ตำนานท้องถิ่น替续器ผิว - การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากมานานหลายปีและไม่มีข้อสงสัยสถานที่ปัจจุบันมีโบสถ์ ส่วนนี้เป็นส่วนที่เหลือเก็บไว้ในโบสถ์หินบะซอลต์กางเขนศักดิ์สิทธิ์กล่าวว่าหินหรือแผ่นหินไข้เพื่อ 3 2 เมตรกว้างเมตรยาว มันเกี่ยวกับอะไรจะปรากฏศตวรรษที่ 3 ผู้หญิงทุกข์ทรมานจากอาการไข้ของน้องสี่ประกาศว่าเธอจะรักษาเขาจากการขยายของ เนื่องจากการรักษาคุณก็จะได้พบกับสมเด็จพระสันตะปาปา替续器ที่หนึ่งจอร์จเป็นอัครสาวก替续器วางแผนยี่ห้อปานกลางยังอธิบายเป็นคำพูดตำแหน่งของกวาง สองศตวรรษต่อมาอีกประการหนึ่งคือการรักษาที่ได้รับการอนุญาต vosy พระสังฆราชสังฆมณฑลโรมเมืองนี้จะ ruessio ( เมืองหลวงของ vellave กอล - โรมัน ( ชื่อ ) anicium กอล - โรมัน - หนัง替续器และก้าวร้าวของ " ปี " หมายถึงภาษาเซลติก " รอบวงจรของการตั้งครรภ์ " ) จะถูกสร้างขึ้นมหาวิหาร เริ่มการก่อสร้างและของทายาท scutaire บิชอป ตามประเพณีของโบสถ์เทวดาคือเทวดาศักดิ์สิทธิ์พระธาตุ 2 โรมัน [ จะ ]ในความเป็นจริงเหล่านี้ชื่อตำนานหินที่สามารถมองเห็นจากตำแหน่งปัจจุบันและตั้งชื่อตามชื่อวัดที่พระเจ้า cernunnos กวางอีกานิรุกติศาสตร์ของคำลอย , กอลล์ , เว็บไซต์นี้เป็นหนึ่งในความทรงจำเก่าๆมัน divnit éบูชา ได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นหนึ่งในวิหารต้นแสวงบุญตำนาน , เลอ , มหาวิหารชาทร์ที่เก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของกระบองเพชร . เราพบฐานของคีย์บอร์ดในคณะประสานเสียงที่โบสถ์นี้เป็น 12 เมตร x ยาว 24 ครับตอนนี้ของผู้แสวงบุญบนหินได้รับประโยชน์ถ้าเดิมเป็นหินในการบูชาพระอาการไข้ของยุคกลางและยุคใหม่บริสุทธิ์นมัสการเป็นสีดํา
การแปล กรุณารอสักครู่..


ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.
- -เกือบ 40 ปีกับการศึกษาและทำงานเกี่ยวกับ
- บรรยากาศดีสดชื่นแจ่มใส
- ฉันกำลังหางานอยู่
- except for the fact that he adds an irid
- Fixed exchange ratesIn a system of fixed
- Write an essay about your everyday life,
- can at least temporarilyovercome defolia
- Let my smile back
- แก้ปัญหาที่สาเหตุเป็นทางที่ดีที่สุดไม่ต้
- ยาว
- Wish my smile back
- Practice
- 有一健忘的手病
- This type of financial mastery doesn’t h
- -เกือบ 40 ปีกับการศึกษาและทำงานเกี่ยวกับ
- Do child care subsidies influence single
- break the law
- ฉันสามารถสวดมนต์เป็นภาษาอังกฤษ
- ช่วงเวลานั้นฉันไม่เป็นทำอะไรเลย รู้สึกสม
- มีไข้
- Fixed exchange ratesIn a system of fixed
- could be explained only by a new concept
- may i love you teacher
- oceanic bank