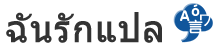- ข้อความ
- ประวัติศาสตร์
Quant au tableau, joyau inestimable
Quant au tableau, joyau inestimable du Louvre, il a moins souffert du temps que des restaurateurs. La couleur de son ciel a verdi; le visage, Jadis éblouissant de fraîcheur, a jauni sous le vernis, et certains détails, comme ceux des cils, ont disparu. Cette toile a inspiré des pages enthousiastes à Michelet, Théophile Gautier, Gustave Planche, à George Sand, etc. Les pages de Vasari sont peut-être aussi les plus simples et les plus éloquentes.
C'est sans doute vers la fin de l'année 1501 que la Napolitaine Monna (ou Mona) Lisa, fille d'Antonio di Noldo Gherardini, vint poser dans l'atelier du peintre. Elle était, depuis 1591, mariée à un gentilhomme florentin, Francesco Zanobi del Giocondo, dont le nom, grâce à l'oeuvre de Léonard, allait devenir universellement célèbre. La Joconde ne devait pas encore avoir atteint la trentaine, quand les séances commencèrent; elles s'espacèrent pendant quatre ans. Pour ne pas laisser gagner son modèle par l'ennui, on assure que Léonard, grand amateur de musique lui-même, lui faisait donner des concerts; en tout cas, il n'épargna rien pour parfaire la peinture. Ainsi qu'il l'a noté dans ses manuscrits, il voulut lutter avec la vie et donner l'illusion d'une créature douée de tous les sens : non seulement capable de voir et de toucher, mais encore d'entendre. Par là, d'ailleurs, se vérifie la subtilité d'esprit de léonard de Vinci, en même temps que le récit des intermèdes de musique de chambre prend aspect de vérité.
Tous les contemporains vinrent admirer la Joconde dans l'atelier de Florence, où Léonard était rentré depuis 1500. On y pouvait voir en même temps le carton définitif de la Sainte Anne, aujourd'hui disparu, et probablement même la peinture qui est maintenant au Louvre. Le portrait n'était pas achevé que le maître s'occupait déjà du carton de la Bataille d'Anghiari. Vasari s'est fait l'écho des contemporains :
C'est sans doute vers la fin de l'année 1501 que la Napolitaine Monna (ou Mona) Lisa, fille d'Antonio di Noldo Gherardini, vint poser dans l'atelier du peintre. Elle était, depuis 1591, mariée à un gentilhomme florentin, Francesco Zanobi del Giocondo, dont le nom, grâce à l'oeuvre de Léonard, allait devenir universellement célèbre. La Joconde ne devait pas encore avoir atteint la trentaine, quand les séances commencèrent; elles s'espacèrent pendant quatre ans. Pour ne pas laisser gagner son modèle par l'ennui, on assure que Léonard, grand amateur de musique lui-même, lui faisait donner des concerts; en tout cas, il n'épargna rien pour parfaire la peinture. Ainsi qu'il l'a noté dans ses manuscrits, il voulut lutter avec la vie et donner l'illusion d'une créature douée de tous les sens : non seulement capable de voir et de toucher, mais encore d'entendre. Par là, d'ailleurs, se vérifie la subtilité d'esprit de léonard de Vinci, en même temps que le récit des intermèdes de musique de chambre prend aspect de vérité.
Tous les contemporains vinrent admirer la Joconde dans l'atelier de Florence, où Léonard était rentré depuis 1500. On y pouvait voir en même temps le carton définitif de la Sainte Anne, aujourd'hui disparu, et probablement même la peinture qui est maintenant au Louvre. Le portrait n'était pas achevé que le maître s'occupait déjà du carton de la Bataille d'Anghiari. Vasari s'est fait l'écho des contemporains :
0/5000
สำหรับตาราง อัญมณีล้ำค่าของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เขาประสบเวลาน้อยกว่า restaurateurs สีของท้องฟ้าได้และวัฒนธรรม ใบหน้า เมื่อพราวสด มีอาจไม่ใช่เคลือบใต้ และรายละเอียดบางอย่าง เช่นขนตา หายไป ผืนนี้ได้แรงบันดาลใจกระตือรือร้นหน้า Michelet, Théophile Gautier, Gustave Planche สนามบิน ฯลฯ หน้าก็อาจจะยังฝีปากมากที่สุดและง่ายที่สุดนั้นอาจจะไปสิ้นปี 1501 เป็น Monna ภาษานาโปลี (โมนา) ลิซ่า ลูกสาวของ Antonio di Noldo Gherardini มาถามในสตูดิโอของจิตรกร เธอได้ จาก 1591 แต่งงานกับขุนนาง Florentine, Zanobi ขุนนางฟลอเรนซ์ มีชื่อ จากการทำงานของลีโอนาร์ด กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โมนาลิซ่าคือยังไม่ถึงสามสิบ เมื่อเริ่มเซสชัน พวกเขามีชีวิตสี่ปี ไม่ให้ชนะรูปแบบ โดยเบื่อ มันใจว่า เลียวนาร์ด บิ๊กเพลงรักตัวเอง ทำเขาให้คอนเสิร์ต ในกรณีใด ๆ เขา spared อะไรที่จะทำการวาดภาพ ตามที่เขาระบุไว้ในต้นฉบับของเขา เขาต้องการต่อสู้กับชีวิต และให้ภาพลวงตาของสิ่งมีชีวิตของความรู้สึก: ไม่เพียงมองเห็น และ สัมผัส แต่ยังไม่ได้ฟัง นอกจากนี้ มีจริงถึงความละเอียดอ่อนของจิตใจของเลโอนาร์โดดาวินชี ในขณะที่เรื่องราวของ interludes หอดนตรีใช้แง่มุมของความจริงทั้งหมดโคตรมาชมโมนาลิซ่าในเวิร์กช็อปของฟลอเรนซ์ ที่เลโอนาร์โดได้กลับตั้งแต่ 1500 มีเห็นที่เดียวกันเวลากล่องสุดท้ายของแซงต์แอนน์ หมดอายุตอนนี้ และอาจแม้กระทั่งการวาดภาพซึ่งขณะนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ภาพได้ไม่สมบูรณ์แบบได้แล้วกระดาษแข็งของการต่อสู้ของ Anghiari ก็เป็นการสะท้อนเสียง โดยโคตร:
การแปล กรุณารอสักครู่..


สำหรับภาพอัญมณีล้ำค่าของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะได้รับความเดือดร้อนเป็นเวลาที่น้อยลงภัตตาคาร สีของท้องฟ้าแวร์ของตน ใบหน้าพราวเมื่อเย็นสีเหลืองใต้ไม้วีเนียร์และรายละเอียดบางอย่างเช่นขนตาได้หายไป ภาพนี้เป็นแรงบันดาลใจหน้ากระตือรือร้นมิเชอThéophileโกติเยร์, กุสตาฟ Planche จอร์จแซนด์ ฯลฯ หน้าของวาซารีที่อาจจะง่ายและฝีปากมากที่สุด. มันอาจจะเป็นช่วงปลาย 1501 Neapolitan Monna (หรือโมนา) ลิซ่าลูกสาวของอันโตนิโอดิ Gherardini Noldo มาถาม ในสตูดิโอของศิลปิน มันเป็นมาตั้งแต่ 1591 แต่งงานกับขุนนางฟลอเรนซ์รานเชสโก้เดล Giocondo Zanobi ที่มีชื่อขอบคุณการทำงานของเลโอนาร์โดจะกลายเป็นที่มีชื่อเสียงในระดับสากล โมนาลิซ่ายังไม่ได้มีรายได้ถึงสามสิบเมื่อการประชุมเริ่ม; พวกเขากลายเป็นน้อยบ่อยเป็นเวลาสี่ปี ที่จะไม่ให้เธอชนะรุ่นจากความเบื่อหน่ายก็จะทำให้มั่นใจได้ว่าเลโอนาร์โดคนรักเสียงเพลงที่ดีของตัวเองทำให้เขาให้คอนเสิร์ต; ในกรณีใด ๆ เขาไว้ชีวิตไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบภาพวาด ในขณะที่เขาระบุไว้ในต้นฉบับของเขาเขาอยากจะต่อสู้กับชีวิตและให้ภาพลวงตาของสิ่งมีชีวิตกอปรของความรู้สึกทั้งหมด: ไม่เพียง แต่สามารถมองเห็นและสัมผัส แต่ก็ยังได้ยิน โดยวิธีการนี้ แต่เป็นความละเอียดอ่อนที่แท้จริงของจิตใจ Leonardo da Vinci พร้อมกับการบรรยายของอสซั่มแชมเบอร์มิวสิคใช้เวลาทุกแง่มุมของความจริง. โคตรทั้งหมดมาเพื่อชมโมนาลิซ่าในการประชุมเชิงปฏิบัติการในฟลอเรนซ์ เลโอนาร์โดที่เพิ่งกลับมาตั้งแต่ปี 1500 ก็จะได้เห็นทั้งการ์ดสุดท้ายของเซนต์แอนน์หายไปในวันนี้และอาจจะเป็นภาพวาดที่แม้ขณะนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ภาพยังไม่เสร็จสมบูรณ์เป็นหลักถูกครอบครองแล้วกล่องของการต่อสู้ของ Anghiari Vasari สะท้อนร่วมสมัย
การแปล กรุณารอสักครู่..


ในนาฬิกาและอัญมณีล้ำค่าของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ที่เขาได้รับจากการกู้คืนเวลาที่น้อยลง สีท้องฟ้ามีใบหน้าสดใสของแวร์ดี ; อดีตสีเหลืองสดมีลักษณะที่บางส่วนของรายละเอียดเช่นขนตาจะหายไป ภาพนี้ได้แรงบันดาลใจจากแฟนเพจ米什莱เยร์ , จานทราย , กุสตาฟหน้าเส้นอาจจะง่ายที่สุดและน่าเชื่อถือมากที่สุดนี้แน่นอนในปลายปีนี้ 1501 เนเปิลส์ ( โมนาลิซ่าลูกสาว ) ) ) ) ) ) ) monna แอนโทนี่ Audi noldo กลาดิอุสนีเป็นไว้ที่ห้องทำงานของจิตรกร เธอจาก 1591 แต่งงานกับขุนนางคนหนึ่งชื่อของฟิออเรนติน่า zanobi ฟรานเชสโกเดลโจกอนโดที่ใช้จะเป็นโลกที่มีชื่อเสียงเลนเนิร์ด โมน่าไม่ได้อีกถึงหลายปี 30 เมื่อการประชุมเริ่มต้นที่พวกเขา espac มากกว่า . . . . . สี่ปี . . . . . . . เพื่อที่จะไม่ทำให้ชนะในแบบของเขาที่น่าเบื่อและเรารับประกันว่าเลนเนิร์ดมีความหลงใหลในดนตรีเองเขาคอนเสิร์ต ; ภายใต้สถานการณ์ใดๆที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงไว้ชีวิตเขาวาดภาพ ดังนั้นเขากล่าวว่าในบทความของเขาว่าเขาอยากให้ชีวิตและการต่อสู้ของสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดของความสามารถทั้งหมดของความหมาย : ไม่เพียงแต่จะสามารถเห็นและสัมผัสได้แต่ก็ยังได้ยินเสียง ที่นี่และเป็นสีสันของเลโอนาร์โดดาวินชีและจิตวิญญาณของดนตรีที่ต้องใช้ข้อมูลกลางของการเล่าเรื่องทั้งหมดของโคตรมาชื่นชมโมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่ปี 1500 ฟิออเรนติน่าเลนเนิร์ด เราสามารถเห็นได้ในเวลาเดียวกันและในที่สุดบอร์ดเซนต์แอนน์ในวันนี้และอาจหายไปสีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ภาพวาดไม่เสร็จอาจารย์ก็เป็นบอร์ดย่อยของการต่อสู้จากแองจี้ เส้นสะท้อนคนเวลาเดียวกัน :
การแปล กรุณารอสักครู่..


ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.
- ทำไมถึงมาคุยกับฉัน
- พ่อชื่อ นายบุญธรรม ปิมปา
- สมเกียรติ เสียงแจ้ว
- This castle is your answer
- ขอบคุณมาก
- ชื่อจริงสหทรัพย์
- using a couple techniques to produce coi
- how much can I carry with me
- เพลงที่ฉันชอบคือเพลง
- 13, 14,we consider the spatially average
- If you are doing their laughing. You hav
- I hope, not me.
- I just find my friend in cover dancen 30
- I already learn so msny languages he he
- สมพร
- ถักสาน
- To obtain a challenging position that en
- เป็นสถานที่แบบไหน
- จวน
- proves My mom likes to try mind.
- ในความคิดของฉันช่วงสอบเป็นช่วงที่เวลาผ่า
- ฉันต้องการประสบการณ์และความสำเร็จในการทำ
- Below the waist
- White Novatec HUB Front Rear Hubs F&R Wi